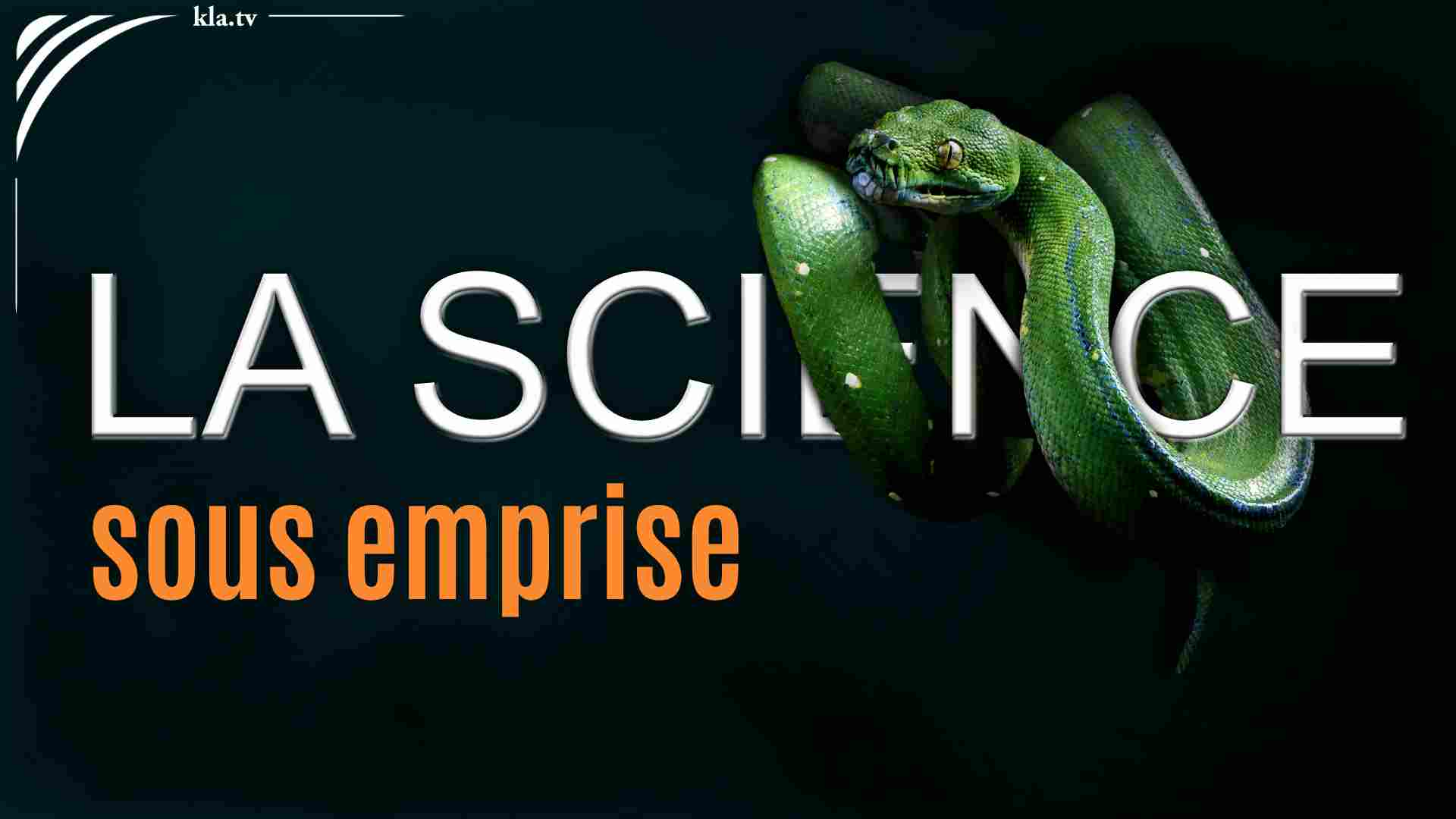
Avez-vous déjà réfléchi à ce qui caractérise la véritable science ? Saviez-vous que dans les années 60, on vantait encore le rôle central du doute dans la science ? On considérait même qu’un débat scientifique ouvert était nécessaire, car c’est la seule façon de garantir le progrès scientifique. Et qu’en est-il aujourd’hui ? Découvrez dans l’émission suivante pourquoi la science libre n’existe pratiquement plus et à quelles conséquences doivent s’attendre aujourd’hui les scientifiques sceptiques.
Dans les médias autoproclamés de référence, les crises mondiales sont toujours expliquées à la population par des connaissances scientifiques. Qu’il s’agisse du changement climatique ou de la crise du Covid, on entend toujours dire que « les scientifiques sont d’accord ». Mais est-ce vraiment le cas ? La science ne vit-elle pas de la remise en question, du doute, du débat entre différents points de vue ?
Richard Feynman, physicien américain et lauréat du prix Nobel, soulignait encore en 1965 le rôle central du doute dans la science. Il a déclaré que la conviction que les experts ne savent pas tout est une caractéristique centrale de la science, ce qui souligne la nécessité du doute et du scepticisme. Ce principe est crucial pour le progrès scientifique, car il permet de poser de nouvelles questions et de repousser les limites de la connaissance. Feynman a insisté sur le fait qu’il ne fallait pas seulement laisser de la place au doute, mais qu’il fallait même l’encourager activement pour progresser.
La réalité est toutefois différente. Hans-Joachim Zillmer, écrivain et chercheur sur l’histoire expérimentale de la Terre, en sait quelque chose. Il s’y oppose avec véhémence et déclare : « C’est une erreur répandue de croire que les nouveaux résultats de la recherche scientifique s’imposent automatiquement. » Selon Zillmer, les médias jouent un rôle clé dans ce processus. Sous contrôle politique, ils décident quelles connaissances et quels modèles doivent être propagés et lesquels ne doivent pas l’être.
De même, les anciennes théories sont supprimées si elles contredisent la vision nouvelle du monde. Les anciennes théories tout comme, pour citer Zillmer » les idées radicalement nouvelles et peut-être précieuses ne reçoivent aucun soutien pour être rendues publiques ». Christof Kuhbandner est un scientifique qui, pendant la crise du Covid, s’est retrouvé dans le collimateur de la presse grand public parce qu’il mettait lui aussi en doute les avis des soi-disant experts. Dans un entretien avec Gunnar Kaiser, il exprime ce qu’il considère comme le cœur de la science.
« En tant que scientifique, je ne parle en principe jamais de vérités.
Il y a une phrase de Richard Feynman, physicien et prix Nobel, qui dit : « Le cœur de la science est en fait la mise en doute des experts ». Donc, si je pense scientifiquement, j’ai le devoir de remettre en question les opinions des experts et de faire progresser les connaissances de l’humanité. Et là, il y a souvent une confusion des rôles, même dans la communication scientifique, chez certaines personnes. En fait, je devrais toujours dire à ce sujet : « Est-ce que je m’exprime en tant que scientifique ou en tant qu’expert ? »
« En tant que scientifique, on a même le devoir de remettre en question toute vérité présentée par des experts. C’est la mission même de la science. »
Celui qui fait cela en tant que scientifique, cependant, en subit rapidement les conséquences.
Le professeur Michael Meyen, spécialiste en sciences de la communication, fait l’objet d’un feu nourri de la part des médias établis, ce qui l’a maintenant conduit à une exclusion professionnelle totale. Dans son nouveau livre « Comment j’ai perdu ma fac » Meyen ne décrit pas seulement les détails d’une campagne dans laquelle il a perdu presque tout ce qui faisait de lui un scientifique, mais il analyse également un contexte plus profond et systémique : la transformation radicale des universités au cours des 30 dernières années. Il s’agit de la commercialisation, de l’adaptation, de la peur et d’une politisation de la recherche. Meyen écrit : « Nous voulons certes la démocratie, mais nous choisissons qui peut participer. »
La physicienne et militante pour le climat Sabine Hossenfelder remet désormais en question la méthodologie utilisée pour associer certains phénomènes météorologiques extrêmes au changement climatique. Elle dit : « De nombreux climatologues savent à quel point les études qui sortent de ce centre de cartographie météorologique sont lacunaires, mais ils se taisent. »
« Il y a beaucoup de climatologues qui savent très bien que cette prétendue recherche n’est pas fiable, mais ils ne disent pas un mot parce que ce serait politiquement inconfortable. »
Anke Uhlenwinkel, professeur d’université en didactique de la géographie et des sciences économiques, a récemment publié un livre : « Celui qui dérange doit partir – L’éloignement des professeurs critiques des universités ». Dans l’interview qu’elle a accordée à AUF 1, elle décrit le fait que de plus en plus de professeurs perdent leur emploi – non pas à cause d’un mauvais travail scientifique, mais parce qu’ils posent des questions gênantes.
Ce qui était autrefois des lieux de débats libres sont aujourd’hui des institutions de peur, de censure et d’uniformisation politique. Celui qui ne correspond pas au récit dominant est renvoyé. Dans un entretien avec Elsa Mittmannsgruber, elle parle des abus de pouvoir, de la mise au pas et de la trahison de l’idée de science. Elle est également d’avis que chaque citoyen ne peut se faire sa propre opinion que s’il a accès à toute la gamme des faits scientifiques.
« … et plus on est au courant des choses qu’en fait on pourrait tous connaître, et c’est beaucoup plus que ce qui est normalement discuté dans l’espace public… plus on en sait, plus on peut bien sûr se faire une opinion personnelle un peu fondée et aussi une opinion sociale. »
« Alors qu’en fait, la science communique ouvertement les choses au sein de la science, oui, nous le voyons avec les protocoles du RKI, on y a discuté de science, mais pour ainsi dire, ce qui a été rendu public était quelque chose de complètement différent. Oui, et dans cette crise Covid, certains scientifiques qui, je pense, avaient effectivement quelque chose d’utile à dire, n’ont tout simplement pas été entendus, ils ont été comme marginalisés. Nous y viendrons, car certaines personnes de notre étude en font partie, et si elles avaient été entendues, nous aurions eu au moins deux avis, et nous aurions pu décider nous-mêmes, en tant que citoyens, ce que nous trouvions finalement le plus convaincant. Si cela ne se produit pas, c’est-à-dire si nous disons : « Follow the science » – c’est de toute façon une expression qui est aussi peu scientifique que possible, parce que la « science » ne prétend rien. La « science » ne parle pas de bien ou de mal, mais en science, nous parlons de certains faits, d’hypothèses, d’expériences, quoi que nous fassions.
On peut poser des questions, faire des sondages, et dire : Ok, maintenant il en est ressorti ceci et cela, mais il n’y a pas forcément de « bon » et de « mauvais ». On y lit simplement le pourcentage de répondants ayant déclaré ceci ou cela. Et ensuite, en tant que citoyen, je peux me faire ma propre opinion lorsque je suis bien informé, que ce soit pour juger si cela est préoccupant ou pour dire : « Bon, d’accord, tous mes amis disent la même chose, pourquoi vous énervez-vous autant ? » C’est à moi d’en décider. Mais si je n’ai pas cet éventail de résultats réels et qu’on me dit, oui mais il y a ce résultat et nous le suivons, alors je ne peux justement plus le faire et c’est là qu’une société n’est plus libre, car on ne donne plus la liberté de décision à l’individu. »
Dans l’interview, le professeur Anke Uhlenwinkel parle également de ce qu’on appelle les fonds de tiers, avec lesquels la recherche est financée.
« Oui, les fonds de tiers sont un point très important. On y trouve généralement ce qui est souhaité en termes de « bonnes choses » et on y trouve aussi quelques mots à la mode, pour ainsi dire, qu’il faut absolument inscrire dans ces demandes de fonds de tiers pour avoir une chance. Et entre-temps, il y a en fait des fonds de tiers qui sont mis au concours et qui sont déjà pratiquement attribués. »
Le professeur Werner Kirstein a également abordé ce problème de financement lors de la 14e AZK et a inventé le terme « changement climatique politogène ».
« J’ajouterai plus tard que de très nombreux fonds de soutien sont mis à disposition ici, bien sûr par l’UE et par les différents États. De nombreux scientifiques sont donc recrutés pour développer des programmes climatiques, pour faire de la recherche dans ce domaine afin d’obtenir des fonds. Le fait est que, venant moi-même d’une université, nous avons vu que le financement de base dans les universités ne suffisait pas du tout pour organiser un fonctionnement vraiment normal. Alors, que fait le scientifique ? Il consulte le catalogue des subventions de l’UE et le catalogue des subventions allemandes, et ça existe aussi dans d’autres pays. Et maintenant, on voit qu’on trouve un thème quelconque qui correspond au changement climatique et ensuite je fais une demande, je formule une demande, je soumets la demande à l’autorité correspondante. Et voilà que dès que le mot réchauffement climatique ou augmentation de la température apparaît dans un contexte quelconque, l’argent afflue. La chose la plus curieuse que j’ai vécue, c’est quand un groupe de biologistes, donc pas du tout des climatologues – ils ne savaient pas du tout ce qu’était le changement climatique, le réchauffement de la planète, ok, on peut s’en occuper – et puis le sujet des biologistes était : « Le comportement des vers de vase quand la température augmente » ! Nous en sommes arrivés à ce point, le sujet n’a plus aucune importance, l’essentiel est que ce soit le changement climatique et que l’argent coule à flot.
Oui, alors vous voyez les généreux sponsors, donc il n’y a pas que l’UE qui subventionne ce genre de choses, les ministères fédéraux subventionnent aussi ce genre de demandes et la recherche a de quoi faire. Ça concerne beaucoup de mes collègues, alors je leur dis : « Mais qu’est-ce que vous faites, vous ne vérifiez pas la véracité des faits, qu’est-ce qui se passe ? » « Eh bien, nous avons besoin d’argent, l’argent doit affluer. Comment allons-nous exister si nous n’avons pas d’argent ? » Et puis, bien sûr, on peut à nouveau embaucher des doctorants, on peut ainsi acheter des ordinateurs, on peut investir dans des appareils, du personnel, etc. et il y a de l’argent. Mais pour ça, il faut des subventions, et peu importe alors le thème choisi, pourvu que le sujet ait un rapport avec le réchauffement climatique. C’est triste, mais c’est comme ça que ça marche. »
Les scientifiques ne devraient donc pas du tout être d’accord, car la science vit de la remise en question, du doute et du débat ouvert. Il est évident que la recherche dépend de la politique par l’attribution de subventions et qu’elle est ainsi contrôlée. Le public n’est informé par les médias dominants que des découvertes scientifiques qui sont politiquement voulues. Ainsi, les scientifiques sont pris au piège, car leur réputation scientifique et souvent leur existence sont menacées s’ils sortent de ce système. C’est pourquoi je lance un appel à tous les chercheurs sincères – ces scientifiques qui veulent faire de la recherche honnête – pour qu’ils ne se laissent pas corrompre, mais qu’ils élèvent la voix, apportent des preuves contraires et fassent preuve de courage en dénonçant les abus.
de ah./rw.
Sources/Liens : Le mainstream affirme : les scientifiques sont unanimes https://www.klimareporter.de/gesellschaft/ueber-99-prozent-konsens
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2018-08/impfgegner-dokumentation-eingeimpft-wissenschaft-kritik/seite-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Konsens_zum_Klimawandel
Citation de Richard Feynman, physicien américain et lauréat du prix Nobel : https://skynetblog.de/zitat-richard-feynman-ueber-zweifel/
https://www.themarginalian.org/2012/08/27/richard-feynman-on-the-role-of-scientific-culture-in-modern-society/
https://www.eejournal.com/fresh_bytes/richard-feynman-on-the-role-of-scientific-culture-in-modern-soci/
Ticket: SE-1693 Citation de Zillmer : Zillmer, Hans-Joachim : Irrtümer der Erdgeschichte (Erreurs de l’histoire de la Terre). Le désert méditerranéen, la forêt vierge du Sahara et la domination mondiale des dinosaures ; Knaur-Taschenbuch, Munich 2003, p. 18-20. Interview Kaiser/Kuhbandner https://3speak.tv/watch?v=gunnarkaiser/oyaignlm
Prof. Michael Meyen https://uncutnews.ch/begrenzte-wissenschaftsfreiheit/
Sabine Hossenfelder https://youtu.be/vDsjeKo3u3o
Prof. Anke Uhlenwinkel https://auf1.tv/elsa-auf1/wer-stoert-muss-weg-wie-kritische-wissenschaft-systematisch-entsorgt-wird
Prof. Werner Kirstein www.kla.tv/12016
Source : Kla Tv




















